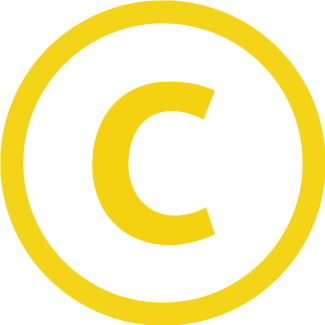Liraz
Liraz, la chanteuse israélo-iranienne primée, est de retour avec Roya (« fantaisie » en farsi), exaltant patchwork de rythmes traditionnels et modernes et de sonorités persanes.
Enregistré en secret à Istanbul avec son groupe de Tel-Aviv et des musiciens iraniens de Téhéran qui n’ont pas froid aux yeux, Roya est un portail musical vers un lieu de paix, de joie et de liberté sans entraves.
Des ombres à travers une fenêtre décorative. Une porte s’ouvrant au plus profond d’un ancien palais désert. Un voile bleu chatoyant à travers lequel des yeux cerclés de khôl observent et s’ouvrent grand. Intrigue. Mystère. Passé et présent se chevauchent. Roya.
Le troisième album de la chanteuse israélo-iranienne Liraz est une invitation au rêve. Des hymnes, des chansons d’amour, de lumineux airs de dance moyen-orientaux... Une collection de 11 titres qui enrichissent ce mélange caracté- ristique de rythmes traditionnels et modernes et de sonori- tés persanes, Roya (« fantaisie » en farsi) conçoit la musique comme un portail magique, une arche vers un lieu de paix, de joie et de liberté sans entraves, sans tchador.
« Mon fantasme, je rêve de la paix dans le monde », chante- t-elle en farsi, de sa voix d’or, sur le morceau titre halluci- natoire. « Je ne perdrai pas espoir / Tu verras, nos cœurs se croiseront. »
Liraz et son sextet israélien (trois femmes, trois hommes) ont enregistré Roya en dix jours à Istanbul, dans un studio en sous-sol, à l’abri des regards et crépitant de créativité.
Avec eux, au violon, à l’alto et au tar (le luth iranien en bois qui a la forme d’une guêpe), se trouvaient des compositeurs, compositrices, des musiciens et musiciennes de la capitale iranienne, Téhéran. Les mêmes musiciens anonymes qui avaient déjà collaboré avec Liraz en ligne, sans poser de questions, sans montrer leur visage, sous le radar de la po- lice secrète de Téhéran, pour son album Zan, en 2020. Des musiciens qui ont voyagé sous couverture de Téhéran à Is- tanbul afin de travailler avec Liraz et le producteur et multi- instrumentiste Uri Brauner Kinrot en chair et en os.
C’est du moins ce que Liraz a imaginé.
« Il existe un passage unissant notre langue et notre cœur, qui renferme les secrets du monde et de l’âme », a écrit Rumi, le plus grand mystique soufi et poète de langue perse, dont Liraz chérit la prose. « Tant que notre langue est blo- quée, le canal est ouvert / Au moment où notre langue se délie, le passage se ferme. »
« Est-ce que c’était juste dans ma tête ? Est-ce que j’étais vraiment dans la même pièce que mes sœurs et mes frères de cœur iraniens ?»
Liraz marque une pause, agite sa main d’un geste délicat. « Je ne me souviens que de fragments : la peur et le stress que j’ai ressentis quand j’ai su qu’ils étaient en chemin. Nos larmes de joie et de soulagement quand nous nous sommes embrassés. Et la musique que nous avons faite ! C’était une telle musique ! » Elle sourit. « Elle est sortie de nous, tout simplement. »
Cordes serpentines à travers les pulsations électroniques et les guitares wah-wah, « Azizam » est une merveille psyché- délique, sur des paroles qui parlent d’obsession détraquée (« Tu es le mal qui me tue / Moi, avec mon amour pour toi »). Sur une musique écrite par le bassiste Amir Sadot, « Doone Doone » est une ode enjouée aux musiciens téhéranais avec lesquels Liraz s’est liée d’amitié par l’intermédiaire d’écrans d’ordinateur, et qui auraient pu être présents pour enregis- trer avec elle. « Mimiram » livre des protestations d’amour dramatiques avec une irrévérence délibérée, tandis qu’« Omid » (qui est à la fois un nom d’homme et le mot farsi pour « espoir »), avec des paroles d’une musicienne irani- enne anonyme et une musique de Ilan Smilan, co-auteur de Zan, parle d’un homme nommé Hope, et de l’espoir, qui est aussi un homme.
Chanson lente et solitaire sur l’Iran, « Tanha », composée de cordes et de synthétiseurs, a été enregistrée le jour où les Iraniens sont peut-être arrivés, ou pas, à Istanbul. « Je chante à propos des frontières qui ont fondu entre nous », explique Liraz, qui a écrit les paroles et coécrit la musique avec Smilan et Brauner Kinrot. « J’ai beaucoup pleuré entre les prises. »
Son accent hébreu intact (« C’est mon histoire, mon choc des cultures »), sa confiance renforcée par des récompenses prestigieuses (elle a été l’artiste Songlines de l’année 2021) et une large reconnaissance internationale, Liraz n’a jamais semblé aussi passionnée, aussi forte et rebelle. Roya est donc la nouvelle étape d’une carrière très médiatisée qui se distingue par sa volonté de lutter contre l’oppression et de défendre le droit des femmes du monde entier à chanter, à se produire et à être entendues.
« Israël et l’Iran ne vivent pas en paix. Les Israéliens ne peu- vent pas se rendre en Iran, et les Iraniens ne peuvent pas se rendre en Israël. Si les Iraniens contactent les Israéliens, ils vont en prison », explique Liraz, dont les parents, des juifs séfarades d’origine iranienne, sont partis pour Israël à l’époque où les deux pays entretenaient des liens étroits, – mais où, y compris avant la révolution islamique de 1979, être juif en Iran devait rester secret.
Sa grand-mère désirait faire carrière comme chanteuse, une profession interdite aux femmes en Iran.
« Elle a 85 ans et c’est toujours une grande chanteuse : l’autre jour, j’ai mis un disque d’un chanteur iranien et elle s’est levée et a chanté à tue-tête. Ma famille a besoin de chanter », dit Liraz, qui a grandi en dansant sur la musique de divas comme Ramesh et Googoosh, célèbres à Téhéran dans les années 60 et 70, l’âge d’or de la pop persane. Elle aimait aussi les chanteuses : Kate Bush, Tori Amos...
Après des cours de chant, de musique et de théâtre (et une période en club), elle a travaillé trois ans aux Etats-Unis en tant qu’actrice, apparaissant dans des films à gros budget tels que Fair Game et A Late Quartet. A Téhérangeles (le quartier iranien de Los Angeles), Liraz a trouvé les siens, et a embrassé sa part perse : « L’Iran m’a toujours semblé être un amant dont je me languissais. Je peux sentir ce que c’est que d’être iranien, mais je ne suis pas dans cette bulle à l’intérieur de l’Iran. »
« Ce paradoxe a fait de moi une rêveuse », poursuit Liraz, qui, dans un élégant virage artistique et personnel, est ap- paru en 2020 comme un agent du Mossad parlant farsi dans la série Apple TV d’espionnage Tehran. « Et si j’étais née en
Iran et que je ne pouvais pas chanter, est-ce que je tenterais de m’échapper ? Il y a toujours tellement d’histoires et de visions dans ma tête. Mais je sais que j’ai besoin de chanter, je dois chanter, pour les femmes muettes d’Iran. Et je veux chanter pour l’Iran mes sentiments pour ce pays. »
Sorti en 2018, Naz, son premier album, une collection de reprises de chansons pop principalement pré-révolution- naires de ses chanteuses iraniennes préférées, a illuminé les médias sociaux iraniens. Liraz a reçu des vidéos de femmes au visage joyeux dansant à l’intérieur de leur mai- son, exit tchadors, foulards et voiles. Des musiciens iraniens ont commencé à lui envoyer des clips, des paroles et des mélodies via des fichiers cryptés, et c’est ainsi que les chan- sons de Zan – et ses liens avec les musiciens anonymes – ont pris forme.
D’album en album, Liraz est devenue plus audacieuse, plus franche (demandez-lui de parler de la Palestine et elle van- tera aussi les droits des Palestiniens). Si l’enregistrement dans un studio secret avec les musiciens de Téhéran était un fantasme, celui-ci était palpable. L’étincelant « Bishtar Be- hand » saisit le pouvoir de guérison du rire et de la solidarité. « Gandomi », dont les paroles et la musique ont été écrites de façon anonyme, fait l’éloge de la relation amoureuse et de l’engagement interculturels. Alors que « Joonyani » parle d’amour fou, d’embrasser des photos chaque nuit, le ciné- matographique « Bi Hava » – riche en cordes et tranquille – semble boucler le cercle de l’amitié entre Liraz, son groupe et les musiciens de Téhéran.
« Je chante que ce n’est pas un jour que nous allons nous rencontrer. Nous sommes déjà là les uns avec les autres, ici et maintenant. Alors profitons de la chance d’être en- semble. »
C’est précisément ce qu’ils font sur le morceau de clôture, une version féminine du morceau d’ouverture, « Roya ». « J’avais ressenti tellement de puissance de la part de ces femmes qui arrivaient d’Iran, confie Liraz. Nous sommes devenues comme des sœurs. Le dernier jour, une heure avant que tout le monde parte, j’ai demandé aux Iraniennes et aux trois femmes de mon groupe d’enregistrer une fusion organique, vivante, de “Roya”. »
« On y est parvenu en une seule prise incroyable. Nous avons pleuré au moment de nous serrer dans les bras et de nous dire au revoir, et puis, comme si de rien n’était, tout le monde était parti. » Ses yeux sombres clignotent. « Comme s’ils n’avaient jamais été là du tout. »
Quelque part dans le passé, flottant en direction de l’avenir, un voile bleu s’envole, libre, dans le vent.